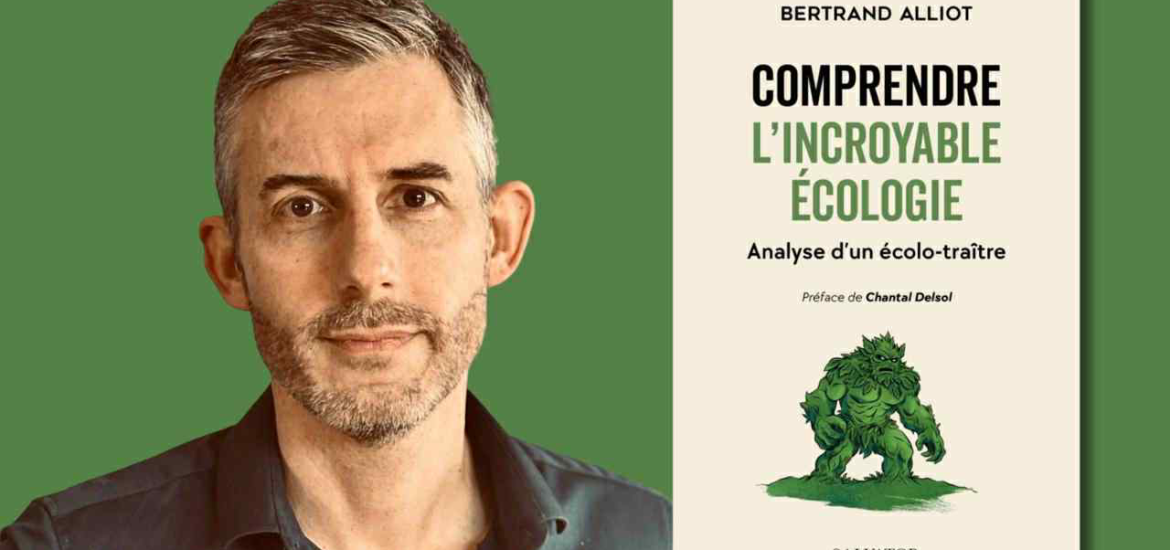
Avec Comprendre l’incroyable écologie, analyse d’un écolo-traitre, préfacé par Chantal Delsol, Bertrand Alliot signe son deuxième essai (1). Après une histoire naturelle de l’homme, ouvrage dans lequel il comparait l’homme à un ours vivant à proximité d’un tas d’ordure, l’enfant terrible de l’écologie, entreprend une fois de plus de remettre celle-ci à l’endroit.
Convertis en goguette, biodiversitocrates en panique
Passé de l’autre côté du militantisme avec son ONG Action Écologie, il tient une chronique hebdomadaire sur YouTube dans laquelle il ne manque pas une occasion de tacler ses anciens confrères pour leurs frasques irrationnelles. Il repart donc à la charge avec cette fois le renfort d’un autre vert célèbre, l’incroyable Hulk, dont on peut admirer une caricature sur la couverture de l’ouvrage. Il faut dire qu’il en faut des muscles pour lutter contre ce phénomène qui, tel le lierre, s’est incrusté un peu partout et a envahi notre quotidien.
Alliot en a fait la triste expérience. En octobre 2024 il a pris l’initiative d’organiser un symposium intitulé « comprendre le phénomène écologie » à l’Institut de France, sous le patronage de l’Académicienne Chantal Delsol (2). Cette initiative qui est passée de justesse sous les fourches caudines de la censure, n’est toutefois pas restée sans conséquence pour notre organisateur, puisque ceci lui a valu d’être mis au placard par l’Université Gustave Eiffel, son employeur.
Mais la foi des convertis est inaltérable. Pour ceux qui s’interrogent sur ce qualificatif, je l’avais utilisé dans Greta a tué Einstein (3) pour caractériser ces anciens militants d’ONG écologistes qui après avoir quitté celles-ci avec fracas, les critiquaient et s’engageaient pour défendre une vision positive de la civilisation industrielle et du progrès technologique en insistant sur le fait que c’était le meilleur moyen de protéger l’environnement. L’ex-militant de la LPO s’étonne de ne pas trouver plus de convertis en France ; l’espèce est beaucoup plus prolixe dans les pays anglo-saxons remarque-t-il (4) . Le plus célèbre d’entre-eux étant sans doute le fondateur de Greenpeace, Patrick Moore qui a quitté l’association lorsqu’elle a voulu faire une campagne anti-chlore ; vient ensuite l’écologiste sceptique Bjorn Lomborg qui ne manque pas une occasion de dénoncer l’anti-humanisme de l’écologie politique; l’ancien militant anti-nucléaire Michael Shellenberger devenu tech-évangéliste; le britannique Mark Lynas, anti-OGM devenu pro-OGM pour sauver le climat; le philosophe de formation Alex Epstein aujourd’hui expert énergéticien défendant la thèse de la liberté énergétique cause du développement humain…. Et on pourrait encore en citer une quantité d’autres.
En France, Bertrand Alliot est bien seul – à l’exception peut-être de Jean-Claude Jaillette (5) – à avoir fait marcher la partie de son cerveau (le lobe frontal ?) responsable du scepticisme. Avec une forme d’ironie grinçante au regard de la tournure qu’on pris les événements (ce monsieur a perdu son emploi à l’Université française à cause de ses opinions !), il se présente comme un écolo-traître sur la couverture de son ouvrage. On est alors en droit de se demander ce qui l’a poussé à quitter la LPO, pour rejoindre Action Écologie ? Lui qui répète fièrement qu’il s’intéresse à l’ornithologie depuis l’âge de 12 ans. Ce n’est pas parce qu’il est allé raconter dans les colonnes du Point (6) qu’il y avait des bonnes nouvelles de la biodiversité et que certaines espèces animales se portaient mieux, que l’on doit penser soudainement qu’il n’aime plus les oiseaux et est devenu lui-même un ennemi de la biodiversité…? A la limite, s’il menace quelqu’un dans ce milieu, c’est bien les biodiversitocrates, le seul groupe garanti de proliférer sur le dos de l’extinction des autres espèces tant que le contribuable acceptera de financer.
Studios Marvel et film catastrophe
Pour comprendre ce qui a poussé Bertrand Alliot à changer de point de vue sur l’écologie, il faut donc lire son nouvel ouvrage. Il y passe aux rayons X ce phénomène et se demande « pourquoi malgré le renforcement constant de la législation dans le domaine de l’environnement, l’alarmisme écologique a continué de grandir ».
Nous résumerons ici quelques points forts de l’ouvrage. Alliot à la différence d’autres auteurs (dont je fais partie) ne se contente pas de distinguer écologie scientifique et écologie politique, mais il fait un distinguo fondamental, pour ne pas dire essentiel entre écologie (le meneur) et environnement (le suiveur) et c’est là sans doute l’idée la plus remarquable de l’ouvrage : « Pour filer la métaphore, l’environnement, c’est le paisible Bruce Banner (l’incarnation de l’environnement) qui, à la suite d’une situation de stress, se transforme en Incroyable Hulk ( l’écologie ) en prenant, ce qui est anecdotique dans l’univers de Marvel mais significatif dans le nôtre, une couleur verte… »
Ce qui motive l’écologiste, ce qui le fait se lever le matin, c’est la recherche du salut, d’une part en rejetant le progrès technologique, d’autre part en cherchant à renouer avec le mode de vie traditionnel. Cette quête du salut est d’inspiration religieuse. Elle peut être d’ordre privé (le survivalisme) ou publique (la décroissance et la sobriété qu’Alliot relie au concept de peur exponentielle développé par Benoit Rittaud).
Le développement durable est quant à lui une forme d’écologie amoindrie (Bruce Banner ne réussissant pas à se transformer) : « la thèse du développement durable vient consacrer le diagnostic de crise écologique, mais pour le faire accepter, minimise l’effort à produire, voire le réduit à presque rien. » Mais ce n’est pas le DD et sa recherche d’un optimum de pollution qui l’a emporté, c’est l’écologie qui a triomphé et sa volonté de gouverner la société à coup de crises existentielles avec la crise climatique d’abord et le GIEC qui est là pour objectiver le catastrophisme. Cette crise initiale est suivie de crises de remplacement « Le développement technologique, le climat, la démographie, la couche d’ozone, la biodiversité sont des problèmes planétaires qui mettent en danger l’ensemble de l’humanité. »
Des crises mondiales qui nécessitent un salut mondial et un récit de crises existentielles qui peut s’étendre à l’infini. La logique écologique s’impose à la place de la logique environnementale : on ne vise plus à produire des denrées agricoles, mais à capturer du CO2; l’énergie abondante et bon marché est moins essentielle que le fait qu’elle soit décarbonée. Les politiques interviennent alors pour mettre en place des formes d’exercice sous contraintes (la décroissance). C’est vrai surtout au niveau de l’UE qui choisit la vie de l’ermite … le danger étant que personne ne voulant vivre ainsi, elle se retrouve isolée.
Pour renforcer son point de vue l’écologie va alors créer de l’idéologie… L’auteur fait un commentaire très intéressant : « en réalité une crise véritable ne devrait susciter aucune idéologie, mais simplement une réaction. » La thèse sous-jacente étant que la crise a moins de réalité que la posture salutaire dans laquelle se place les idéologues verts.
C’est en ce sens que l’anthropologue explique le « pourquoi de l’écologie » : elle se veut une « une religion séculière, marquée à la fois à l’échelle individuelle et à l’échelle collective par l’espérance du salut. Pour les raisons que nous avons expliquées, l’individu est révolté par la destruction de la nature. À partir de cette expérience fondatrice, il construit un récit dont l’être humain est le héros. Celui-ci est à la fois destructeur et sauveur. » ce qui le place d’emblée dans l’ordre du religieux. Dans une dernière analyse rapide, l’auteur imagine que le mouvement risque de se tarir car il demande trop de sacrifices et s’avère trop exigeant, il en appelle à un retour à l’environnement (thèse qu’il reprend de son premier ouvrage cité précédemment).
Ce que l’on apprécie dans l’ouvrage de Bertrand Alliot c’est le style léché et impeccable … l’essai se lit d’un trait comme un roman. Les idées s’enchaînent, le propos est limpide, accessible au plus grand nombre. Il cite quelques sources et offre une courte ( trop courte ?) bibliographie d’auteurs triés sur le volet. Toutefois, même au travers de cette légèreté, on sent que les fondamentaux sont maîtrisés et assimilés et ceux qui détestent les notes de bas de page peuvent se réjouir.
Description anthropologique vs explication politique
Sur le fond maintenant, Bertrand Alliot qui entend faire un travail d’anthropologue, affirme avoir expliqué le phénomène « écologie ». De mon point de vue, il en a magnifiquement décrit la forme, mais on cherche encore la raison, le « pourquoi » de ce qu’il considère comme une religion. Est-ce parce que la nature a horreur du vide que celle-ci finit par s’imposer comme un substitut des religions déclinantes ? Il y a sans doute une part de vérité dans cette thèse d’autant plus que l’espérance du Salut se fait plus que jamais ressentir dans les foules. D’ailleurs Alliot nous dit « C’est parce qu’il est un être religieux (il est mortel et a donc besoin d’un récit sur le Salut) qu’il met en scène un récit vers le bien (sauver la planète) grâce à la mise en scène d’un être (lui même) qui est maléfique. Donc cette « écologie religieuse » serait consubstantielle de la nature humaine ? Mais alors ce phénomène ne peut-il pas être remplacé par n’importe quelle autre religion ? Et si c’est le cas, on a juste observé et décrit, on n’a rien démontré.
Cela pose d’autant plus de questions que l’auteur laisse flotter la nature du phénomène, hésitant souvent entre “idéologie” et “religion”. Ne lui jetons pas la pierre, car en cela il rejoint beaucoup de critiques de l’écologisme qui ne font pas la distinction et ne cherchent pas à la faire.
Pourtant il me parait important d’insister sur le fait que l’écologisme est davantage une idéologie : elle se présente comme une théorie alternative (7) à une autre conception du monde (en l’occurrence ici la science prométhéenne) ; autrement dit, elle n’existe que par opposition à l’univers de référence de celle-ci (la civilisation industrielle) et elle s’affirme en imposant sa vision et en écrasant toutes les opinions qui osent la contredire. Elle prétend imposer sa pseudo théorie pour modeler le monde actuel (par exemple « revenir en arrière en restaurant la nature »). Et pour cette raison, elle doit absolument s’emparer du pouvoir politique.
A contrario, une religion existe pour elle-même (et non comme une alternative qui s’oppose à une autre religion) ; elle n’est pas obligée de s’engager en politique pour exister. Elle cherche à donner du sens à l’existence. Rien n’empêche, par exemple, qu’un individu ait une conception religieuse de la nature, cela peut d’ailleurs être vu comme quelque chose de sain. C’est quand l’idéologue s’organise politiquement pour imposer sa vision du monde à autrui et éliminer les contrevenants que survient le danger, car c’est à ce moment que la religion devient idéologie.
Aussi, ce distinguo n’est pas anodin car il ne suffit pas de décrire l’écologie, il faut en comprendre la cause pour soigner les symptômes mais également leurs origines. Or, de mon point de vue, la politique scientifique (qui étudie les idéologies) est plus à même d’expliquer le « pourquoi » de l’écologisme et de ce fait, d’en saisir et d’en corriger les défauts. En l’identifiant comme une idéologie qui est née dans le creuset d’un déficit de politique scientifique on saisit qu’elle veut faire une OPA sur le concept de nature et ne comprend pas que l’humanité utilise la science et la technologie essentiellement pour s’adapter à son environnement. Elle part du principe qu’il existe une lutte des classes « homme nature » et pense au final que toute tentative humaine de modifier celle-ci est apparentée à une forme de destruction ou de prédation (8).
Le converti Bertrand Alliot a bien saisi cette idée quand il propose de revenir à “l’environnement” plutôt que de continuer sur la voie de l’écologie; mais pour se débarrasser de la crise existentielle et de l’alarmisme, il faudra renouer avec la confiance en la science prométhéenne (celle qui modifie l’environnement pour que nous puissions nous adapter). Ce qui implique de la débarrasser autant que possible de toutes formes d’idéologies et cela ne se fera pas tout seul.
En attendant de trouver la solution, « Comprendre l’incroyable écologie » est un excellent livre à mettre absolument entre toutes les mains.
(2) Sont intervenus à cet événement Jean de Kervasdoué, Benoit Rittaud, Philippe Fabry, Thomas Lepeltier, et moi-même… https://youtu.be/jsFRtezahJw?si=PkNOZfkwKDaCbI2h
(3) Jean-Paul Oury, Greta a tué Einstein, VA éditions (Déc 2020)
(4) https://www.youtube.com/watch?v=H2MbQ-SsjMo
(5) Ancien chroniqueur de Libération a qui on doit la couverture « Alerte au soja fou » qui a déclenché la querelle des OGM et qui s’est racheté quelques années plus tard en écrivant il faut sauver les OGM, après avoir lu la prose de Marcel Kuntz et de moi-même sur le sujet
(6) https://www.lepoint.fr/societe/la-biodiversite-ne-s-effondre-pas-en-europe-20-10-2024-2573177_23.php
(7) Voir à ce sujet notre analyse sur la transgenèse végétale, considérée comme non naturelle par les anti-OGM, Jean-Paul Oury, la Querelle des OGM (PUF 2006)
(8) Jean-Paul Oury, de Gaia à l’IA, (VA éditions, Déc 2024)
A lire également
« Il faut repenser la nature et l’écologie au-delà des mythes » C. Lévêque – entretien
« Il faut plus de dialogue sur l’évolution de la relation homme animal » Bernard Vallat (Interview)
« La grande mystification verte nous conduit à la ruine ! » Jean de Kervasdoué (Interview)
« La spirale dynamique est un outil pour comprendre les crises » Christian Sempéres (Interview)
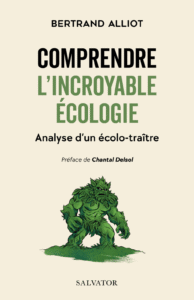
Même s’il faut saluer le converti et lui reconnaître une qualité d’activiste peut-être plus cinglante que celle de celui qui n’a pas commis d’apostasie, il ne faut pas oublier que pour atteindre le bon rivage, il aura fallu que celui-ci ait été construit et maintenu au cours de l’histoire, sans repentance ni pardon.🤤
Ceci dit, je me réjouis de lire cet ouvrage.