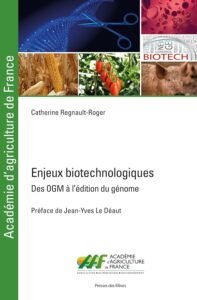L’Union européenne a engagé en 2019 la révision de la réglementation européenne qui sera appliquée aux nouvelles variétés de plantes génétiquement éditées (issues des nouvelles techniques génomiques, NTG ou NGT -new genomic techniques). La procédure est non seulement longue mais aussi semée d’embûches, comme j’ai eu l’occasion de l’exposer dans cette revue récemment (1). Elle n’est pas encore achevée et connaît de nombreuses péripéties.
En France, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) qui évalue les conséquences des choix scientifiques et technologiques pour en informer le Parlement français, suit de près ce processus et a décidé de faire le point sur les dernières avancées du débat en cours.
Les travaux de l’OPECST sur l’édition génomique : déjà en 2017 puis en 2021
Ce n’est pas la première fois que les NGT sont l’objet des travaux de l’OPECST. On se souvient du premier rapport publié dès 2017 par le député Jean-Yves Le Déaut et la sénatrice Catherine Procaccia et intitulé « La révolution de la modification ciblée du génome (sous-titre : Les enjeux économiques, environnementaux, sanitaires et éthiques des biotechnologies à la lumière des nouvelles pistes de recherche) » (2). Ce rapport majeur de 366 pages a été réalisé après plusieurs enquêtes internationales réalisées in situ, de nombreuses tables rondes et auditions de spécialistes. Il constitue un ouvrage de référence sur le sujet qui était nouveau à l’époque.
Au cours de la mandature suivante, la sénatrice Catherine Procaccia a poursuivi le travail engagé sur les NGT avec le député Loïc Prudhomme (Jean-Yves Le Déaut était devenu parlementaire honoraire, concluant ainsi une très longue carrière de parlementaire au service des politiques publiques de plus de trente années !). Un nouveau rapport fut publié qui s’intitule « Les nouvelles techniques de sélection végétale en 2021 : avantages, limites, acceptabilité » (3). Après avoir réuni en mars 2021 plusieurs tables rondes d’acteurs du débat scientifique et sociétal sur les NGT, les auteurs de ce rapport ont insisté sur la nécessité de la révision de la directive 2001/18/CE. Ils ont recommandé que les évaluations des risques des nouveaux produits soient basées sur leurs caractéristiques finales et non sur la technique d’obtention. Ils ont également proposé que la directive soit réexaminée tous les cinq ans pour prendre en compte les avancées des techniques et le débat public. Ils ont aussi dénoncé le vandalisme anti-biotech dans les champs et les laboratoires, et se sont inquiété des difficultés à mener des recherches de biotechnologies en France ainsi que de la fuite des cerveaux à l’étranger. En conclusion le rapport a insisté sur « la nécessité que la propriété intellectuelle garantisse de bonnes conditions à la recherche et l’innovation, en l’occurrence la création variétale, dans un objectif d’intérêt public. »
Une note scientifique récente en juin 2025
C’est dans ce prolongement que l’OPECST poursuit son travail de veille en publiant en juin 2025 une note scientifique de l’Office (n°47) signée par le député Pierre Henriet, vice-président de l’OPECST, et la sénatrice Martine Berthet (la sénatrice Catherine Procaccia étant devenue entretemps parlementaire honoraire). Intitulée « un nouveau règlement pour les plantes issues des nouvelles techniques génomiques » (4), cette note scientifique indique que son objet est motivé par le fait que le règlement européen s’appliquant directement au niveau de l’Union sans transposition nationale, il ne sera pas examiné par le Parlement français. Dans ces conditions, il apparaît à l’Office « nécessaire de jouer son rôle d’informateur en présentant le contexte scientifique et réglementaire des NGT, les différents points du texte qui font débat et les spéculations qu’il suscite ».
Ayant auditionné plus de 25 personnalités et organismes, spécialistes et professionnels du secteur des biotechnologies et des semences, le comité de travail piloté par les deux parlementaires s’est attaché à préciser la place des NGT dans la sélection variétale et les perspectives qu’elles ouvrent, ainsi que les propositions effectuées par la Commission européenne et les modifications votées au Parlement. La note examine les débats autour de l’étendue de la modification génétique autorisée dans un génome pour bénéficier de l’allégement réglementaire appliqué aux plantes remplissant certains critères (catégorie NGT-1), mais aussi la gestion des risques et de la traçabilité alors que certaines modifications génétiques opérées en laboratoire ne sont pas distinguables de l’évolution génétique naturelle des plantes récoltées en plein champ. Les enjeux économiques autour de la brevetabilité et la propriété intellectuelle sont également l’objet de toute leur attention.
Les parlementaires qui soulignent un certain nombre d’insuffisances conceptuelles des propositions effectuées dans les textes des instances européennes, indiquent dans leurs recommandations, l’importance de l’ouverture du marché de l’Union européenne aux NGT.
lIs préconisent la nécessité de prendre des mesures concrètes pour développer de nouvelles variétés obtenues par ces techniques, par exemple en réintroduisant des essais en champ de plantes NGT, ce qui avait été abandonné pour les essais de plantes OGM en raison des saccages répétés opérés par des activistes environnementalistes antibiotech. Ils appuient les recommandations de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) sur la mise en place d’une surveillance post-commercialisation environnementale (5). Ils insistent sur le besoin d’instaurer un dialogue constructif et serein entre les acteurs avec des consultations locales, d’installer un comité d’évaluation pluridisciplinaire « chargé d’examiner les impacts systémiques des variétés NTG sur le système agricole français » et également de mettre en place des règles de propriété intellectuelle de manière à « prévenir toute évolution du secteur vers un oligopole ».
Cette note succincte (9 pages), condensée mais fouillée sur le plan argumentaire, photographie à un instant « t » les débats sociétaux en cours sur les NGT en France et en est elle-même le reflet. En cela, elle constitue un élément utile pour comprendre les enjeux économiques et participer au débat sociétal.
Références :
- Catherine Regnault-Roger (2025) NGT : la nouvelle réglementation européenne dans les turbulences parlementaires. The European scientis 1.07. 2025 https://www.europeanscientist.com/fr/opinion/ngt-la-nouvelle-reglementation-dans-les-turbulences-parlementaires-europeennes/
- Jean-Yves Le Déaut et Catherine Procaccia (2017) La révolution de la modification ciblée du génome Rapport de l’OPECST, n°4618 AN et N°507 Sénat 14 avril 2017, 366 pages
- Catherine Procaccia et Loïc Prudhomme (2021) Les nouvelles techniques de sélection végétale en 2021 : avantages, limites, acceptabilité, Rapport n°4220 AN et n° 671 Sénat, OPECST, 3 juin 2021, 122 pages
- Pïerre Henriet et Martine Berthet (2025). Un nouveau règlement européen pour les plantes issues des nouvelles techniques génomiques (NTG), note scientifique n°47, n°1576 AN et 738 Sénat, 9 pages.
- ANSES (2024) Avis et rapport de l’Anses relatif aux méthodes d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des enjeux socio-économiques associés aux plantes obtenues au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques (NTG) https://www.anses.fr/fr/content/avis-et-rapport-2021-sa-0019
Ouvrage de l’auteur
A lire également
« Green deal, F2F : je pense le plus grand mal des plans européens » Catherine Procaccia (Interview)
« Il faut plus de dialogue sur l’évolution de la relation homme animal » Bernard Vallat (Interview)
« Agrofourniture : ne perdons-pas notre autonomie ! » A. Fougeroux (Interview)
This post is also available in: EN