
Qu’est-ce qui peut bien pousser deux auteurs qui cumulent à eux-seuls « trente-deux années d’étude supérieures, douze diplômes, dont deux doctorats, cinq Grandes Écoles et deux agrégations » à sortir un titre provocateur tel que « Ne faites plus jamais d’étude » * ? Laurent Alexandre et Olivier Babeau, ces deux surdoués des plateaux TV, feraient-ils l’apologie du cancre ? Ont-ils à leur tour tué Einstein ?
Lanceurs d’alerte
Derrière la galéjade on pressent le sujet grave. Dans le nouveau livre qu’ils viennent de co-signer, Laurent Alexandre et Olivier Babeau se sont mués d’éditorialistes en lanceur d’alerte pour avertir l’humanité des risques qu’elle court face au tsunami de l’intelligence artificielle.
Les avancées de cette dernière, notamment via les LLM et autres robots conversationnels ont rendu non seulement le savoir, mais aussi certaines compétences gratuites : un phénomène qui touche essentiellement et quasiment toutes les professions intellectuelles – les cols blancs – telles que le droit, la médecine, la finance ou encore la communication ; des secteurs qui se croyaient protégés jusqu’à aujourd’hui. Les métiers manuels, pour l’instant épargnés, seront victimes de la deuxième vague avec l’arrivée de la robotique (Le pack ChatGPT + robot humanoïde) qui transformera « la souveraineté technologique via le remplacement des travailleurs humains par une classe robotique asservie, locale et pilotable. »
Le plus alarmant selon les auteurs n’est pas le phénomène en lui-même, « c’est l’indifférence d’une humanité qui ne se sent pas encore expropriée de son monopole cognitif alors qu’elle l’est déjà. » C’est face à ce silence assourdissant qu’il convient de se révolter.
Cerveau humain « has-been »
Le problème dont l’humanité n’a pas conscience est celui de son absence de compétitivité sur le marché du travail, face à l’IA et à la robotique. Il y a tout d’abord un facteur anthropologique contre lequel elle ne peut rien faire : « le cerveau est un chef d’oeuvre dépassé » affirment Alexandre et Babeau, « Il évolue lentement alors que le monde bascule dans l’exponentielle technologique (…) il est dépassé par les exigences du monde qu’il a lui-même contribué à créer. »Des propos dignes d’un Ray Kurzweil.
A cela s’ajoute un facteur cognitif : « Plus un travail repose sur des connaissances formalisées, apprises, sur les bancs de l’école, plus il est facile pour une intelligence artificielle de l’imiter. » Ce qui ne veut pas dire pour autant que cela signe la fin du travail. Une nouvelle ère s’annonce et pour la décrire les auteurs s’appuient sur le corpus idéologique du transhumanisme car nous n’allons pas fabriquer des espadrilles bio avec l’IA. Les fantasmes qu’elle génère sont bien plus fondamentaux (tuer la mort, comprendre nos origines, conquérir le cosmos, augmenter nos possibilités…) « un avant gout de ce monde où la vie, la technologie et la pensée auront fusionnée. » Et pour parvenir à ces nouvelles ambitions, il va falloir être créatif et inventer de nouveaux métiers, les auteurs s’essayent à une liste : « prompt engineer, AI ethicist, AI product manager, décision Architect, model tuner, feedback loop Analyst, AI interaction designer…. »
Nouvelle « Algorithmocratie » et chute de l’enseignement
Cette nouvelle ère signe la fin du monde d’hier et du pouvoir d’élites qui se reposaient sur la rente cognitive… Une nouvelle aristocratie voit le jour, celle qui possèdera l’infrastructure (actif stratégique ultime) sur laquelle reposera l’IA. Les auteurs évoque l’émergence d’une nouvelle aristocratie, osons le terme Algorithmocratie (1) même s’ils ne l’emploient pas.
Que faire face à cette « nouvelle technologie qui arrive dans un monde qui, par définition, s’en passait très bien. » ? Quels sont les métiers qui résisteront le plus longtemps ? Faut-il construire un » mur de Berlin numérique » pour protéger l’ancien monde, sachant que « la barrière a un coût » ?
C’est à ce moment qu’il convient de rappeler que l’université – déjà en ruine – est totalement dépassée par le phénomène IA. Les auteurs parlent d’université Potemkine, voient le diplôme comme une relique barbare, considèrent que le QI est en désarroi (les étudiants ont un QI inférieur à GPT5)… Or une erreur consiste à laisser les étudiants seuls avec l’IA car ils risquent d’en faire un usage primaire et de voir leur cerveau s’atrophier.
Alexandre et Babeau balayent les différents secteurs sinistrés : médecine « l’IA soigne mieux que les médecins »; économie « le vrai patron de 2030, ce n’est plus un ancien de l’INSEAD. Ce sera un modèle d’IA. » ; recherche « Les modèles d’IA développent des intuitions que les humains ne peuvent pas posséder. »
Repenser le modèle éducatif de fond en comble
L’enseignement doit donc se réinventer en profondeur: « le professeur doit incarner moins la connaissance que la méthode » et les élèves doivent étudier autrement : l’important n’est plus le diplôme, mais la « stratégie cognitive ». Or, la force de l’IA est qu’elle propose une véritable individualisation du savoir (contrairement aux MOOC qui ont déçu par rapport à la promesse).
Des considérations qui prouvent bien qu’Alexandre et Babeau ne sont ni des anarchistes, ni des nihilistes. Aussi, page 197, ils dévoient l’intégralité de leur titre : « ne faites plus d’étude au sens traditionnel et figé du terme. Les études telles qu’on les entendait hier sont mortes ; vive l’étude, continue, agile et protéiforme, tout au long de la vie ! »
Le professeur pourra devenir un « directeur de conscience » tandis que les étudiants doivent créer leurs « startup cognitive » et rechercher l’originalité pour échapper à la standardisation qui est le propre de l’IA. Des inégalités sont à craindre, notamment pour ceux qui ne sauront pas se démarquer par rapport à ce que sait/peut faire la machine. Quant à la réussite, elle est au coin de la rue pour ceux qui possèdent une audience ou un algorithme.
Guide et manifeste
Pour systématiser leur réflexion les auteurs proposent 14 commandements dédiés aux étudiants, tels que « apprenez à apprendre », « n’apprenez pas à coder », ou encore « apprenez en continue toute la vie »… pour ne citer que les trois premiers.
Et pour parachever l’esprit pratique de l’ouvrage, un manifeste des droits de l’étudiant arrive à point nommé en conclusion pour nous rassurer sur le fait que les auteurs ne sont pas des technoprophètes aveuglés par l’innovation dont ils annonceraient le caractère inéluctable et dramatique pour l’humanité. Face au tsunami, ils réclament une série de droits, avec entre-autre, « un droit à l’accès à l’éducation IA qui doit être intégrée dans un nouveau contrat social. »
Etudier toujours pour optimiser notre libre responsabilité
Ce livre vient donc un peu comme la sonnerie de la récrée réveiller l’élève dissipé et somnolant ainsi que son prof qui passe son temps à le surveiller. Jusqu’à présent le premier vit une lune de miel avec l’IA qu’il utilise pour torcher ses devoirs, tandis que le second désemparé n’a pas d’autre solution que de sanctionner ou d’interdire. Un modèle qui n’est pas viable et qu’il est urgent de changer.
Une fois le diagnostic posé, on apprécie le fait que les auteurs ne se contentent pas de prédictions catastrophistes. Les 14 préconisations et le manifeste, permettent notamment à l’ouvrage d’échapper à la diatribe apocalyptique et en font une réflexion sur les principes d’une bonne politique scientifique (2). Il sort du cadre d’une idéologie (de type transhumaniste-posthumaniste, par exemple )qui consisterait à accepter la fatalité du progrès technologique sans se poser la question fondamentale : celui-ci permet-il d’optimiser notre libre responsabilité. En effet, en proposant de repenser l’enseignement (plutôt que de construire un mur de Berlin contre l’IA, ou au contraire en se soumettant à toutes ses externalités négatives), les auteurs donnent à l’humanité ses chances d’échapper à de nouvelles formes de déterminismes. Ils s’interrogent sur la possibilité qu’il nous reste d’échapper à l’asservissement par les algorithmocrates. En tâche de fond on retrouve également, la question posée dans Deep Utopia par Nick Bostrom : « Que fera l’humanité le jour où l’IA aura résolu tous les problèmes ? »
Alexandre et Babeau ont donc raison d’insister sur le fait qu’il faut, non pas une réforme (chloroforme ?) de l’enseignement, mais un changement total de paradigme qui redéfinisse le rôle du maître, de l’élève et leur rapport à l’IA. C’est à ce prix que l’humanité échappera à l’écueil d’une société faites de « purposeless » (sans formation, sans métiers, sans vocations, sans emplois) vivants de minima sociaux, mis sur la touche, car non compétitifs par rapport à des innovations technologiques concurrentes toujours plus concentrées entre les mains d’un petit nombre d’individus. Pour échapper à ce scénario catastrophe, il ne faut plus faire d’étude, il faut en faire plus, toujours, tout le temps : et de ce point de vue, on peut considérer que la totipotence du cerveau humain est un atout inégalé qui permet à l’homme de s’adapter en permanence (et non pas seulement de « fonctionner »). Ce qui lui permet de rester ouvert à de nouvelles idées qui n’ont jamais été pensées, garantie de sa liberté. De ce point de vue – et ce serait la principale critique que je ferai aux auteurs – il est loin d’être dépassé, mais ils ont raison de marteler que face à l’IA il est impératif de libérer encore davantage son potentiel.
*Ne faites plus d’études: Apprendre autrement à l’ère de l’IA
1) Voir chapitre 5 de Greta a ressuscité Einstein, Jean-Paul Oury (VA éditions, 2022)
2) Voir 4eme partie de Gaïa à l’IA, Jean-Paul Oury (VA édition, 2024)
A lire également
Et vous, que ferez-vous le jour où l’IA aura résolu tous les problèmes ?
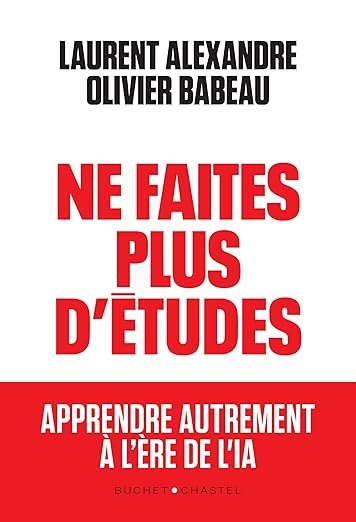
Si seulement Laurent Alexandre pouvait se taire !