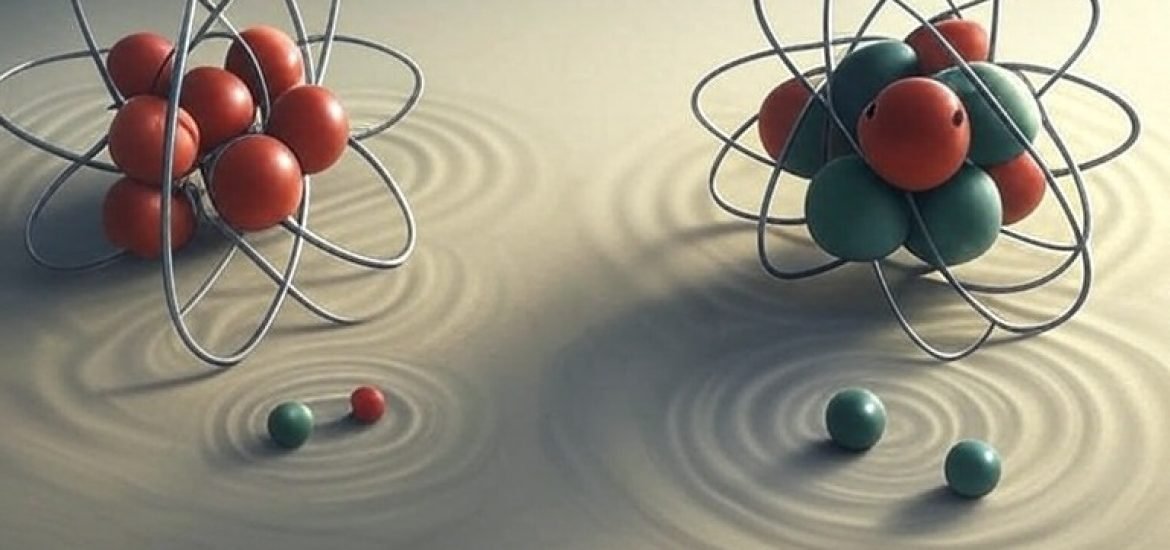
Quoi qu’il en soit, notre salut énergétique est dans les neutrons rapides de Stellarium et non dans les hyper-rapides de l’hypothétique progéniture d’ITER
Père du surgénérateur Superphénix de loin le plus avancé de son temps, le regretté Georges Vendryes déclarait ceci en 2003 : « Je ne crois pas que la fusion thermonucléaire puisse constituer à terme prévisible une méthode pour produire des quantités significatives d’électricité. Seul l’avenir – un avenir qu’aucun de nous ne connaîtra – le saura. Pour le moment gardons-nous d’abuser l’opinion en lui présentant comme une réalité à portée de main ce qui n’est au mieux qu’un espoir. À la lecture des articles suscités dans la presse par le projet ITER, je ne puis m’empêcher de penser que le risque est grand qu’on égare le public. Il est clair pour moi qu’aucune politique de l’énergie ne saurait tenir compte de la fusion thermonucléaire parmi les sources auxquelles il sera possible de faire appel, au moins à l’échelle du présent siècle. »
Valse des bombes atomiques
Vingt-deux ans plus tard, tout ce que la planète médiatique compte de prophètes partisans en mal de rupture technoscientifique idoine s’extasie devant les exploits réputés à portée de main dont nous abreuve une communication au service des intérêts bien compris de R&D privés ou d’État, de leurs bailleurs de fonds, de la géopolitique et des multiples idéologies souvent antagonistes entre elles instrumentalisant le tout. Pour ces gens, l’accès prométhéen à la mère de toutes nos énergies est si proche que, en la matière, il n’y a aucun mal à franchir le pas entre la fable démagogique et la propagande. Mollement conscients que l’existence de tout ce qui palpite ici-bas est suspendu à cette énergie détenue en propre par l’astre du jour, une majorité d’entre eux ne démord pourtant pas à dénier au soleil une responsabilité prépondérante dans le réchauffement climatique terrestre.
En se faisant l’écho de la promesse par le MIT d’un réacteur à fusion nucléaire plus puissant et moins cher qu’Iter (1) ou de l’annonce de la construction par la Chine du plus gigantesque laser à fusion nucléaire du monde (2), cette communauté d’observateurs autorisés ne recule devant aucun dithyrambe. Mais on tombe de l’armoire en découvrant ce à quoi elle accorde publiquement crédit, sans la moindre résistance intellectuelle, avec l’annonce de la construction par Microsoft d’une centrale à fusion nucléaire destinée à alimenter ses usines et les data center (3). Dans sa désopilante chanson, « la valse des bombes atomiques » (4), Boris Vian brocarde d’ineptes ministres payant de leur vie d’avoir cru qu’on peut fabriquer une bombe atomique dans son garage. Pareille satire pourrait bien se révéler prémonitoire des dégâts socioéconomiques susceptibles d’être causés par la stupidité collective, dans le même ordre d’idées.
Réal’ITER
Il est donc plus que temps de rappeler une bonne fois pour toutes à nos compatriotes de quoi il est question avec cette R &D sur la fusion thermonucléaire qui n’a pas encore dépassé le stade de la recherche, ni même celui de la découverte exploitable.
En l’état actuel des choses, ITER – pas plus d’ailleurs que ses concurrents – ne saurait être assimilé à un projet technologique et/ou industriel ; beaucoup s’en faut. Car tout réacteur à fusion soulève trois types de problèmes, tous fondamentaux : la maîtrise des réactions de fusion proprement dites, la production préalable des éléments à fusionner et la tenue des matériaux des enceintes de confinement. Ne s’intéressant qu’à la première de ces questions, ITER n’est pas une machine conçue pour résoudre les deux autres, condition pourtant sine qua non à toute mise en œuvre à l’échelle industrielle.
Dans le Soleil, des noyaux d’hydrogène – autrement dit des protons – fusionnent pour former des noyaux d’hélium. Mais ce cycle de réactions n’est pas suffisamment efficace : elles sont trop lentes pour une utilisation industrielle. Le projet consiste donc à fusionner un mélange de deux sortes d’hydrogène lourd, du deutérium (D) et du tritium (T). Chaque réaction de fusion D + T produit un noyau d’hélium parfaitement inerte et stable, mais aussi un neutron dont l’énergie à exploiter est colossale : 14 MeV. Le tritium ne se trouvant pas à l’état naturel, la fusion thermonucléaire ne peut être considérée comme une source d’énergie inépuisable, ni même propre, dans la mesure où elle produit des cendres d’hélium ; mais, surtout, elle génère des rayonnements dix fois plus énergétiques que tout ce qu’on peut rencontrer dans les centrales nucléaires actuelles, y compris celles à neutrons rapides.
On ne connaît aujourd’hui aucun matériau résistant à une telle irradiation. Or, il est impérativement nécessaire de confiner le mélange deutérium + tritium à fusionner dans des conditions d’étanchéité absolue. Sous l’impact de ces neutrons hyper rapides, les atomes d’un acier ordinaire cassent, produisant des bulles d’hélium rendant le matériau poreux, donc impropre au confinement nécessaire. Un matériau résistant à ces flux neutroniques doit donc être inventé. Nous l’avons dit, la machine ITER n’a pas vocation à étudier la tenue des matériaux sous irradiation forte et prolongée ; elle est seulement conçue pour ne produire que quelques bouffées de neutrons vers la fin de son exploitation et ne surtout pas fonctionner en continu comme devra le faire un réacteur de production énergétique.
Quant au combustible, la nature abonde certes de deutérium, mais pas d’un tritium instable dont la demi-vie radioactive est de douze ans. Jusqu’à présent, ce dernier n’a été produit qu’en très petites quantités nécessaires à la fabrication des bombes H. Un réacteur à fusion thermonucléaire d’un seul gigawatt en brûlera de l’ordre de 56 kg par an, beaucoup plus que la capacité de production totale des réacteurs actuels sur plusieurs décennies. C’est pourquoi il est prévu de le produire massivement en utilisant les neutrons précités pour casser du lithium stocké dans une couverture tritigène placée à l’intérieur des hypothétiques réacteurs du futur, ce que la machine ITER ne prévoit pas non plus d’étudier. En définitive, cette dernière se révèle n’être qu’un grand instrument de recherche fondamentale visant à étudier les gaz chauds ionisés dont la stabilité dans un énorme aimant en forme d’anneau pose à son tour une série de problèmes à résoudre.
Con’fusion
Pour domestiquer la fusion, on recourt à deux approches : le « confinement inertiel » et le « confinement magnétique » du milieu réactionnel. Le premier met en œuvre des faisceaux de rayons laser de haute énergie, projetés à une cadence très élevée sur de minuscules billes de deutérium ; c’est le procédé retenu par exemple par le projet EAST Chinois. La seconde approche, plus prometteuse dans la perspective de la réalisation d’une centrale industrielle, utilise comme ITER le confinement magnétique du milieu réactionnel, un gaz très ténu d’hydrogène complètement ionisé qu’on appelle plasma.
En fait, ce n’est pas avec l’hydrogène lui-même qu’on peut opérer, mais avec son isotope de masse atomique double, le deutérium 2H, présent dans l’hydrogène naturel à raison d’un atome sur 6700. Pour que des réactions thermonucléaires de fusion s’auto-entretiennent dans un plasma de deutérium, sa température doit être portée à environ 500 millions de degrés Celsius ; on imagine sans peine la quantité d’énergie qu’il convient de fournir pour amorcer une telle fusion.
Une étape intermédiaire déjà ambitieuse consiste à utiliser non pas du deutérium pur, mais un mélange de deutérium et de tritium permettant de réduire d’un facteur 5 la température du milieu, ce qui signifie néanmoins 100 millions de degrés. Devant être régénéré en permanence, le tritium radioactif 3H – l’isotope de l’hydrogène de masse atomique 3 – devrait être tiré d’une réaction nucléaire bien connue qui, sous l’impact d’un neutron, forme un noyau de 3H à partir d’un noyau de 6Li, ce dernier constituant 7,5% du lithium naturel. Ainsi, les perspectives énergétiques offertes par la fusion sont-elles déterminées par l’importance de ressources en lithium probablement tirées de l’eau de mer à raison de 0,17 g par m3, d’une part et, d’autre part, de ressources en Deutérium également tirées de la mer à raison de 33 mg par litre, au prix de 5000 euros par Kg.
Plan sur la comète ?
Résumons : le coût de tout instrument à fusion thermonucléaire promet d’être durablement exorbitant dans tous les cas d’un développement abouti suivant les exigences caractérisées ci-avant, ce dont on est encore très loin, qu’il s’agisse de confinement magnétique ou de confinement inertiel ; ceci sans tenir compte du coût d’une installation électrogène à concevoir spécifiquement de toutes pièces. L’instrument ne sera par ailleurs guère plus propre ni guère moins dangereux que les réacteurs à fission actuels et sa ressource en combustible pas aussi inépuisable qu’on aime aujourd’hui à le dire. Enfin, produire un plasma d’hydrogène réunissant toutes les conditions requises pour être le siège d’une réaction thermonucléaire autoentretenue ne semble pas encore pour demain, même si la France peut s’enorgueillir de détenir depuis peu le record de durée en la matière, avec 22 minutes, obtenu par le tokamak West de Cadarache (5).
Bon plan ou plutôt bonne PPE
La salutaire lucidité dont, hélas, nos gouvernants sont depuis longtemps dépourvus dans tant de domaines commande d’admettre que l’accès à une électricité thermonucléaire inépuisable, propre, sans danger et surtout rentable a non seulement peu de chances d’être pour ce siècle, mais pourrait très bien ne jamais être. Pour autant, les recherches fondamentale et appliquée sur la fusion thermonucléaire ne doivent surtout pas être abandonnées pour de multiples raisons dont la principale reste de servir une Science avec un grand S peu ou prou à l’origine de toutes les améliorations de la condition humaine.
Ainsi, la sagesse – celle que l’on attend surtout du Président de la République et de nos ministres – consiste-t-elle à se garder de l’imposture dont il est question au début du présent article et à méditer le conseil que nous donnait Georges Vendryes il y a 22 ans, sonnant aujourd’hui comme un signal d’alarme. Il y a en effet urgence à se remémorer que, si les Français le voulaient vraiment, ils seraient l’un des rares peuples au monde à disposer du moyen d’accès à une production électrique quasi-inépuisable à l’échelle de l’histoire humaine, rentable, propre et sans danger, sous moins de 20 ans. Ce moyen a successivement porté le nom de Phénix, Superphénix et ASTRID, le second ayant délibérément été saboté par un gouvernement réputé socialiste, le troisième tué dans l’œuf par son avatar (6). Or, tandis que les États-Unis renouent à marche forcée avec cette prometteuse filière énergétique à neutrons rapides déjà opérationnelle en Russie et très bientôt en Chine, dans le pays considéré comme son pionnier, une obscure start-up du nom de Stellaria se voit contrainte de mendier des levées de fonds se chiffrant en dizaines de millions d’euros, pour financer un démonstrateur reprenant à zéro le parcours techno-scientifique national qui fit jadis l’admiration du monde (7) ; ceci dans l’indifférence de pouvoirs publics préférant sanctuariser sans état d’âme la marche déjà ancienne vers une indigence énergétique durable se chiffrant, elle, en centaines, voire en milliers de milliard d’euros. Jamais dans l’histoire française et même dans l’histoire européenne la souveraineté de l’impéritie n’a été aussi totale… et aussi décomplexée chez nous, avec la possible promulgation du décret PPE3, dans les prochaines semaines.
(4) https://www.youtube.com/watch?v=8V2aV888ZNo
A lire également
Savoir gré à Marcel Boiteux de son œuvre électronucléaire (première partie)