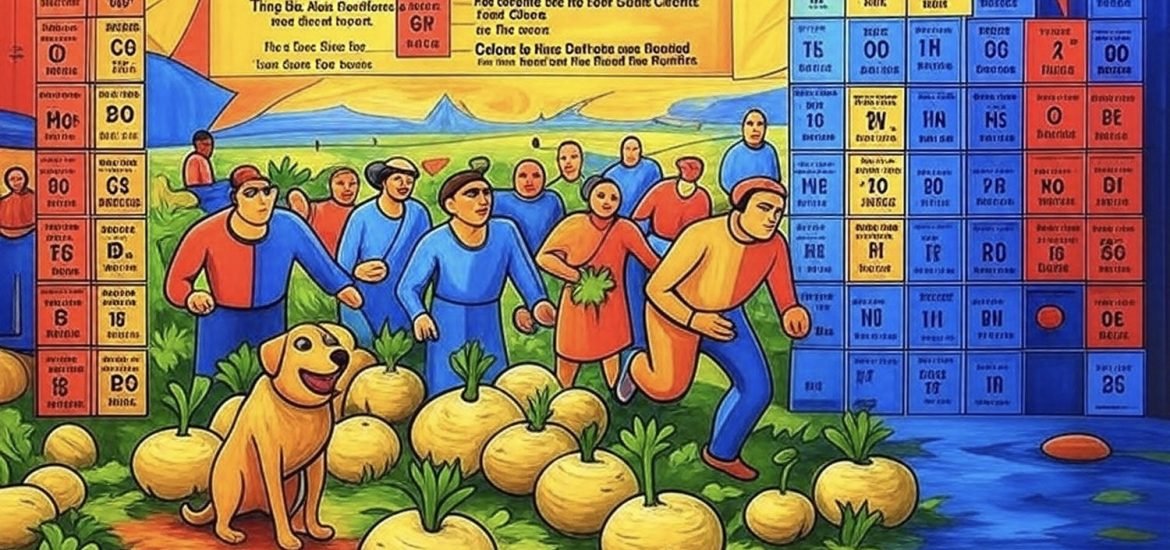
Apprenant qu’une pétition contre la loi Duplomb mobilisait les foules en réaction à l’autorisation d’un insecticide, j’ai tout de suite pensé qu’on était dans un schéma pavlovien qui peut s’illustrer ainsi.
« Considérez une bouteille de liquide étiquetée « monoxyde de dihydrogène ». Un nourrisson assoiffé la boira volontiers, car il ne peut pas lire l’étiquette. Un chimiste assoiffé en fera de même, car il sait que c’est simplement de l’eau. Mais le demi-savant légèrement instruit refusera de boire, intimidé par la nomenclature effrayante. C’est, soit dit en passant, la catégorie dans laquelle beaucoup d’entre vous entreront une fois vos diplômes obtenus. » (1) ajoutez un soupçon de chimiophobie, une dose de manipulation médiatique et vous comprenez en partie pourquoi la pétition contre l’ #acetamipride rencontre un tel succès (a contrario, la pétition qui défend la loi Duplomb a du mal à décoller (2) ).
L’écologisme s’impose une fois de plus en surfant sur l’ignorance du public grâce à ses deux armes favorites :
- Une campagne d’agit’ prop sous forme de pétition lancée par un militant qui donne de la visibilité à un sujet jusqu’alors inexistant dans les médias, en faisant passer un risque potentiel pour un danger.
- Une question non scientifique posée aux scientifiques : « pouvez-vous nous prouver l’existence du risque ‘0’».
Comme je l’ai montré dans Greta a tué Einstein (2), c’est en s’appuyant sur cette double mécanique que l’écologie politique a fait tomber la science prométhéenne de son piédestal et rendu tabou les modifications du vivant, la fission de l’atome, la transmission des ondes et la manipulation des molécules pour ne citer qu’elles. Jusqu’ici rien de nouveau. La Chimiophobie étant à la fois spontanée et renforcée par la propagande des militants. Toutefois, cette analyse reste en surface et il faut répondre à trois questions de fond.
Pour cela je vais m’appuyer sur des textes publiés précédemment dans ces colonnes.
Qu’est-ce qu’un pesticide et peut-on s’en passer ?
C’est la question que se pose Philippe Joudrier dans un texte intitulé « Peut-on imaginer une vie sans pesticides ? » Après avoir exploré la controverse autour des pesticides, souvent accusés de causer des maladies comme les cancers dans un contexte d' »agri-bashing » et de campagnes médiatiques alarmistes, l’auteur y définit les pesticides comme des substances naturelles ou synthétiques éliminant les organismes nuisibles aux cultures, incluant virucides, bactéricides, fongicides, insecticides et herbicides. Il rappelle que les produits phytosanitaires (PPS) sont utilisés dans tous les types d’agriculture, y compris biologique, et même dans les produits ménagers comme l’eau de Javel ou les savons. Il donne l’exemple des nitrites dans le jambon, qui préviennent le botulisme causé par Clostridium botulinum, bactérie qui produit une toxine mortelle à très faible dose, et qui restent indispensables malgré les campagnes pour leur suppression. Quelques cas graves de botulisme ont d’ailleurs fait récemment l’actualité.
Vient alors la problématique de la dose avec la célèbre formule de Paracelse : « Tout est poison, rien n’est poison, c’est la dose qui fait le poison », soulignant que la toxicité dépend de la quantité.
Une problématique qui a été reprise par Bruce Ames dont les travaux ont montré que 99,99 % des pesticides ingérés sont naturels, comme ceux dans une tasse de café, et qu’il n’y a pas de différence toxicologique entre naturel et synthétique.
La nature produit de nombreuses substances dangereuses, contredisant l’idée que « naturel » signifie inoffensif. Par exemple, les toxines Cry de Bacillus thuringiensis (Bt), utilisées en OGM comme le maïs Bt et en agriculture bio via pulvérisations. On pense également à Escherichia coli O157:H7, responsable d’une épidémie mortelle en 2011 via des pousses de fenugrec bio, produisant des shigatoxines. Parmi les toxines naturelles on trouve également les mycotoxines comme l’aflatoxine B1, hautement cancérigène (responsable de cancers du foie), pouvant apparaître (dans certaines conditions de stockage et conservation défectueuses ; sa présence n’est heureusement pas systématique !) dans les céréales et les arachides.
Le Docteur en biologie, qui a été directeur de recherche à l’INRA, conclut qu’une vie sans pesticides est inimaginable, car la nature en est pleine, et que l’homme doit s’en protéger via des produits phytosanitaires, en évaluant toujours le rapport bénéfice/risque.
Les progrès agricoles ont réduit les famines grâce à ces outils, et l’interdiction indiscriminée serait contre-productive. Il plaide pour une approche scientifique équilibrée, loin des peurs irrationnelles amplifiées par les médias. Avec cette première définition bien en tête, on peut attaquer le second problème qui est celui de la détection des pesticides, ce qui nous amène au concept de seuil.
Détection des seuils : ou mettre le curseur ?
Dans un article intitulé « C’est la dose qui fait le poison, non sa détection » Jean-Philippe Vuillez, discute d’un paradoxe moderne : les avancées en analyse environnementale font apparaître notre monde comme plus dangereux en raison des activités humaines, alors que la détection d’une substance ne signifie pas qu’elle était absente auparavant ni qu’elle est forcément nocive.
Les méthodes de dosage ont progressé spectaculairement, permettant de mesurer des concentrations infimes, mais chaque technique a une limite de détection (LD), en dessous de laquelle on ne voit rien, sans que la concentration soit nulle.
L’auteur rappelle également le principe de Paracelse : tout est poison selon la dose, en l’illustrant par l’injection de thallium 201 en médecine nucléaire, toxique à haute dose mais inoffensif en picomolaire.
J.P. Vuillez dénonce une conséquence sournoise : les progrès analytiques donnent l’impression que des polluants augmentent ou apparaissent, alors que les avancées en agriculture, traitement des eaux et industrie les réduisent souvent. Si les méthodes avaient existé il y a 100 ans, on verrait que les concentrations ont diminué dans bien des cas.
L’expert en médecine nucléaire introduit alors une notion fondamentale : « il ne faut pas confondre seuil de détectabilité et seuil de dangerosité. » Les progrès analytiques sont bénéfiques, mais doivent être utilisés correctement, en tenant compte de la quantité, concentration et seuils (détection, normes, dangerosité), souvent dans des ordres de grandeur 1/10/1000. Cessons donc de voir des hausses fictives de polluants dues à de meilleures possibilités de détection.
Enfin, les normes doivent refléter des analyses scientifiques, non varier avec les outils disponibles ; les outils servent les normes, pas l’inverse.
Indépendance de l’expertise scientifique
Dans un deuxième article intitulé « expertise scientifique, qui a le dernier mot ? », JP Vuillez discute de l’indépendance de l’expertise scientifique, particulièrement dans l’évaluation de la toxicité des substances chimiques. Il met en avant comment les conditions de financement influencent l’interprétation des résultats scientifiques.
Mais l’axe essentiel de la réflexion porte sur le fait que bien que la science soit fiable, les conclusions varient selon les orientations politiques : une approche précautionneuse vise à détecter des risques, tandis qu’une autre met l’accent sur les bénéfices.
Cela crée des divergences dans les interprétations des données.
Une fois de plus Paracelse est convoqué. Ainsi, n’importe quelle substance peut être jugée dangereuse ou inoffensive en fonction des seuils d’exposition étudiés (le polonium 210 – naturel mais hautement toxique – ou le cyanure présent dans les amandes amères. Ces cas montrent que des éléments naturels peuvent être mortels à fortes doses.
L’article conclut que la science produit des faits objectifs, mais c’est le contexte politique et les financements qui orientent les conclusions finales : « On voit donc que ce ne sont pas les travaux scientifiques et leurs résultats qui expliquent les décisions politiques, mais bien le contexte politique et la politique de recherche conduite, et plus encore, financée, qui favorisent tels ou tels travaux, et surtout en pétrissent des interprétations pré-établies. La plupart des publications scientifiques sont très valables, mais autorisent en général une réinterprétation, non pas de leurs résultats, mais de l’interprétation qu’on fait de l’interprétation de ces résultats, en fonction d’une grille de lecture politique différente. » En fin de compte, le dernier mot revient à la politique, non à la recherche pure.
Libre responsabilité vs la crise existentielle
Dans son nouvel ouvrage, Bertrand Alliot évoque la crise existentielle provoquée par l’écologie. On l’observe en effet au travers du comportement de l’opinion et de ces deux millions de signataires qui se précipitent pour signer une pétition dont ils ignorent tout du fond du problème, mais simplement par un réflexe pavlovien : l’ignorance et la Chimiophobie causes de l’éco-anxiété.
Dans de Gaia à l’IA mon nouvel essai (3), j’explique que cela peut se comprendre par le fait que l’écologisme est une tentative de combler le déficit de politique scientifique par une idéologie réactionnaire qui s’oppose à un progrès irréfléchi et présenté par ses adversaires comme destructeur.
Une véritable politique scientifique consisterait à avoir une position claire débarrassée de toute forme d’idéologie afin de remettre à plat tous les débats. C’est ce que l’on vient d’essayer de faire :
- La définition et la nécessité des produits phytosanitaires : on ne peut s’en passer et ce n’est pas une question de naturel ou d’artificiel ;
- Les seuils de détection : ce sont eux qui s’améliorent, pas la pollution qui s’aggrave ;
- Le politique interprète les données de la recherche selon son appétence à la prise de risque.
Pour dépasser la pauvreté du débat actuel, il ne s’agirait plus ni de devoir suivre aveuglément l’idéologie verte qui prétend avoir des solutions plus naturelles (ce qui ne veut rien dire), ni de devoir justifier le recours à l’agrochimie, qui s’appuie sur les progrès scientifiques. Mais il faut aller encore plus loin et se poser la seule question qui vaille au sujet de notre adaptation à l’environnement : quelle solution optimise notre libre responsabilité ? C’est selon moi le critère ultime qui doit fonder toute politique scientifique (4).
Est-ce que le recours à un intrant tel que l’Acetamipride accroît notre liberté ? En quelque sorte puisqu’on ne peut se passer de pesticides et que sans eux l’agriculteur ne peut combattre les déterminismes naturels, c’est un outil qui nous permet de mieux nous adapter en nous libérant de certaines contraintes. Est-on responsable quand on utilise cet intrant ? On l’a vu la recherche des seuils de détection des risques est toujours plus performante et à ce sujet, il faudrait mieux appliquer le principe de « cas par cas » que le principe de précaution. En effet, le premier consiste à empêcher toutes formes de généralisation, et à prendre en compte le fait que les innovations scientifiques et techniques suivent une démarche de « pas à pas » et sont en constante amélioration. Enfin c’est aux politiques de faire la synthèse et de définir au regard des études existantes la politique à suivre : veut-on d’une culture de la betterave sucrière sur notre territoire ou préfère-t-on l’importer de chez nos voisins, sachant qu’ils auront recours également aux mêmes intrants ? Cette question relève du domaine de la souveraineté nationale et implique également la libre responsabilité (5).
Autrement dit, pour reprendre les mots de JP Vuillez (6), « la seule posture rationnelle consiste à rechercher le bien-être de l’humanité à travers l’innovation, en maximisant ses bénéfices, tout en réduisant au maximum ses inconvénients. Mais il est illusoire d’imaginer qu’on puisse trouver un mode de vie totalement dépourvu d’aspects négatifs, et surtout pas par un retour en arrière vers une utopique « nature ». La phobie du progrès, alimentée par un réflexe pavlovien face à toute innovation, aggrave en voulant le conjurer, le risque existentiel dont on rappelle qu’il est inhérent à la vie même, et qu’il s’agit non pas de refuser, mais de réduire. A quoi, depuis toujours, la science s’emploie. »
Gageons enfin que le jour où les problèmes de sécurité alimentaire toucheront un nombre toujours plus élevé d’individus les pétitions contre l’agriculture fondront comme peau de chagrin.
- Parabole exposée par Nick Bostrom dans Deep Utopia
- Pétition : Oui à la loi Duplomb
- Jean-Paul Oury, Greta a tué Einstein (2020) VA éditions
- Jean-Paul Oury, De Gaïa à l’IA (2024) VA éditions
- Soulignons la prise de position construite et informée sur X de David Lisnard, maire de Cannes et président de l’AMF
- Jean-Philippe Vuillez travaille actuellement à la rédaction d’une BD de vulgarisation. Vous pouvez participer au projet en contribuant sur Kickstarter
- Une étude de mars 2024 du cabinet Cways fait état d’un taux de 37% de français touchés par l’insécurité alimentaire